Chercheur en inventaire du patrimoine pour le Département du Lot depuis 2019.
- enquête thématique départementale, vallée du Lot de Cahors à Capdenac
- patrimoine ferroviaire
-
Cadot FabienCadot FabienCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.
Chercheur en inventaire du patrimoine pour le Département du Lot depuis 2019.
- (c) Conseil départemental du Lot
- (c) Inventaire général Région Occitanie
Dossier non géolocalisé
-
Aire d'étude et canton
Lot
-
Commune
Cahors
-
Commune
Arcambal
-
Commune
Saint Géry-Vers
-
Commune
Bouziès
-
Commune
Saint-Cirq-Lapopie
-
Commune
Tour-de-Faure
-
Commune
Saint-Martin-Labouval
-
Commune
Cénevières
-
Commune
Calvignac
-
Commune
Larnagol
-
Commune
Cajarc
-
Commune
Cadrieu
-
Commune
Montbrun
-
Commune
Larroque-Toirac
-
Commune
Saint-Pierre-Toirac
-
Commune
Frontenac
-
Commune
Faycelles
-
Commune
Capdenac
-
Dénominationsvoie ferrée
-
Parties constituantes étudiées
La ligne de Cahors à Capdenac, classée dans le réseau des chemins de fer d'intérêt général par la loi du 31 décembre 1875, est déclarée d'utilité publique en 1879 et concédée à la Compagnie du Paris-Orléans en 1883.
Son intérêt est avant tout économique. En effet, se raccordant à Cahors avec la ligne en provenance de Monsempron-Libos, ouverte en 1869, elle va considérablement faciliter l'acheminement du charbon depuis le bassin houiller de Decazeville jusqu'à Bordeaux, via les fonderies de Fumel et les centres industriels de la vallée de la Garonne, en aval d'Agen. Évitant le détour par Lexos et Montauban, la ligne est tracée dans la vallée du Lot, coupant les méandres de la rivière et de ses rives par de nombreux ouvrages d'art, et permettant ainsi d'accélérer la vitesse de transit, gros point faible de la navigation fluviale à qui elle va porter un coup fatal.
En outre, la ligne joue également son rôle de transporteur de voyageurs, assurant les liaisons locales et régionales de service public au profit des populations et favorisant le développement agricole.
La ligne étant une construction de l'État, les travaux relèvent du service des Ponts et Chaussées de Cahors dirigé par l'ingénieur en chef Joseph Lanteirès. La ligne, longue de 68,550 kilomètres, constitue une véritable prouesse technique : commencée au cours de l'année 1881, elle est inaugurée le 14 juillet 1886. Mobilisant plus de 200 hommes, les travaux d'infrastructure sont en effet considérables et donnent lieu, notamment, à l'édification de 13 tunnels, 5 viaducs maçonnés, 4 ponts métalliques, mais aussi 51 passages à niveau avec maisons de garde et 12 stations ou haltes.
Au quotidien, le suivi technique est a assuré par l'ingénieur ordinaire de l'arrondissement de Cahors et celui de Figeac. L'expérimenté Jean-Pierre Lacaze est en charge de l'arrondissement de Cahors, mais il décède en 1885, il est alors remplacé par Eugène-Laurent Heurtault. Pour Figeac, l'ancien conducteur tout juste promu ingénieur, Jean Caillé, en est l'ingénieur ordinaire jusqu'à sa mutation en Cochinchine en 1883. Aucun autre nom d'ingénieur ordinaire n'apparaît dans les archives de 1883 à 1886 pour l'arrondissement de Figeac. Il est possible et probable qu'à partir de 1883, l'ingénieur de Cahors a assuré l'intérim sur Figeac jusqu'à la fin des travaux en 1886.
L'infrastructure de la voie a été divisée en plusieurs lots de travaux soumis à adjudication. Chaque entrepreneur avait en charge la construction d'une portion de la voie ferrée ainsi que l'établissement des maisons de garde.
Les bâtiments ferroviaires sont eux réalisés par des entrepreneurs qui semblent être plus spécialistes de ce genre d'architecture. Ainsi, les stations de gare sont construites par les sieurs Cancalon et Blavy, les haltes ferroviaires sont quant à elles exécutées par un certain Bezanger.
Les aménagements de la voie sont également confiés à des entrepreneurs spécialisés : les semis et plantations des talus sont à la charge de Séguela ; les clôtures sèches et les haies vives sont établies par Alexandre Thuret ; les barrières, poteaux kilométriques et indicateurs de pentes sont installés par Mathias Granges.
Dans l'entre-deux guerres, le rail se révèle être le maillon indispensable dans l'essor de la culture de la fraise lotoise : les temps d'acheminement courts et le respect des horaires ont alors permis la distribution rapide de ce produit recherché vers les marchés parisiens.
En 1934, la Compagnie du Paris-Orléans fusionne avec la Compagnie du Midi puis, avec la nationalisation, la ligne est rattachée au réseau de la S.N.C.F. Concurrencée par le développement des transports routiers à partir des années 1950, l'intérêt de la ligne décroît d'autant plus que l'industrie et les bassins houillers de la région de Decazeville déclinent. En 1966, les lignes Monsempron-Libos et Cahors-Capdenac sont inscrites dans le programme de transfert sur route des dessertes voyageur. Si le transfert de la première est effectif en 1971, la ligne Cahors-Capdenac bénéficie alors d'un sursis avec la présence à Cajarc du président Pompidou. En 1980 elle est finalement fermée au trafic des voyageurs et neuf ans plus tard au trafic des marchandises. En 1993 la voie ferrée va connaître une seconde vie avec son exploitation touristique par l'association Quercyrail jusqu'au début des années 2000.
-
Période(s)
- Principale : 4e quart 19e siècle
-
Dates
- 1886, daté par source
-
Auteur(s)
-
Auteur :
Lanteirès Josephingénieur des Ponts et Chaussées attribué par sourceLanteirès JosephCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.
Ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, en charge de la construction de ligne ferroviaire Cahors-Capdenac.
-
Auteur :
Lacaze Jean-Pierreingénieur des Ponts et Chaussées attribué par sourceLacaze Jean-PierreCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.
Ingénieur ordinaire des Ponts-et-Chaussées, en charge de l'arrondissement de Cahors (Lot).
-
Auteur :
Caillé Jeaningénieur des Ponts et Chaussées attribué par sourceCaillé JeanCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.
ingénieur ordinaire de l'arrondissement de Figeac jusqu'en 1883.
-
Auteur :
Heurtault Eugène-Laurentingénieur des Ponts et Chaussées attribué par sourceHeurtault Eugène-LaurentCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.
ingénieur ordinaire des Ponts-et-Chaussées en charge de l'arrondissement de Cahors (Lot) à partir de 1885.
- Auteur : entrepreneur attribué par source
-
Auteur :
Audbert frères et Jubinentrepreneur attribué par sourceAudbert frères et JubinCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.
-
Auteur :
Soubigou Jean-Pierreentrepreneur attribué par sourceSoubigou Jean-PierreCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.
Entrepreneur, demeurant à Luc-en-Diois (Drôme), en charge des travaux du 4e lot de l'arrondissement de Cahors (adjudication du 22 décembre 1881) de la ligne ferroviaire Cahors-Capdenac.
- Auteur : entrepreneur attribué par source
- Auteur : entrepreneur attribué par source
- Auteur : entrepreneur attribué par source
- Auteur : entrepreneur attribué par source
-
Auteur :
Villetel Josephentrepreneur attribué par sourceVilletel JosephCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.
Père de Jean Villetel qui reprendra l'entreprise.
-
Auteur :
Villetel Jeanentrepreneur attribué par sourceVilletel JeanCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.
Fils de l'entrepreneur Joseph Villetel, il reprend les activités de son père à son décès.
-
Auteur :
Lionnet Victorentrepreneur attribué par sourceLionnet VictorCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.
Construction ligne ferroviaire Cahors-Capdenac : en charge du 2e lot de l'arrondissement de Figeac.
- Auteur : entrepreneur attribué par source
- Auteur : entrepreneur attribué par source
-
Auteur :
Cancalonentrepreneur attribué par sourceCancalonCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.
Entrepreneur ayant fait construire les stations de la ligne Cahors-Capdenac en association avec l'entrepreneur Blavy en 1885. Les deux entrepreneurs sont associés à Arcachon pour les travaux de la ligne de tramway au début du 20e siècle.
-
Auteur :
Blavy Pierreentrepreneur attribué par sourceBlavy PierreCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.
Entrepreneur ayant fait construire les stations de la ligne Cahors-Capdenac en association avec l'entrepreneur Cancalon en 1885. Les deux entrepreneurs sont associés à Arcachon pour les travaux de la ligne de tramway au début du 20e siècle. Auteur de nombreuses constructions de villas à Arcachon. Ce maçon originaire de la Creuse a fondé un véritable empire de la maçonnerie.
-
Auteur :
Bezangerentrepreneur attribué par sourceBezangerCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.
En charge de la construction des stations de type "halte et maison de garde" sur la ligne ferroviaire de Cahors à Capdenac entre 1881 et 1886.
-
Auteur :
Granges Mathiasentrepreneur attribué par sourceGranges MathiasCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.
Pour la construction de la voie ferrée de Cahors à Capdenac, il est en charge de la pose des barrières du passage à niveaux.
-
Auteur :
Heldevert Hersententrepreneur attribué par sourceHeldevert HersentCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.
-
Auteur :
Société des houillères et fonderies de l'Aveyronentrepreneur attribué par sourceSociété des houillères et fonderies de l'AveyronCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.
-
Auteur :
Compagnie du Paris-Orléansservice d'architecture de l'entreprise attribué par sourceCompagnie du Paris-OrléansCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.
-
Auteur :
Thuret Alexandreentrepreneur attribué par sourceThuret AlexandreCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.
- Auteur : entrepreneur attribué par source
-
Auteur :
La ligne de chemin de fer est reliée au départ de Cahors dans le quartier Saint-Georges à la ligne Cahors-Montauban. Elle prend fin à l'entrée de Capdenac près du hameau du Soulié après avoir parcouru 68,550 km. Entre Cahors et Capdenac, la voie ferrée desservait 8 gares et 4 haltes ferroviaires.
Son tracé suit majoritairement la rivière Lot, la franchissant à 5 reprises par des ponts maçonnés ou métalliques. Plusieurs autres ponts sont élevés afin de franchir les affluents du Lot dont le Vers et le Célé.
Les paysages irréguliers de la vallée du Lot contraignent les constructeurs à utiliser divers systèmes afin d'atténuer les dénivelés des versants et ainsi éviter de dévier la voie. Des tunnels au nombre de 13 sont creusés tout au long de la ligne dont le plus long à Coudoulous mesure près de 787 mètres. Les dénivelés sont également franchis par des ponts maçonnés à arches.
Enfin, la voie ferrée est coupée à de nombreuses reprises par les routes, notamment la D 662 qui longe également le Lot. Pour parer à ces difficultés, 48 ponceaux sont édifiés et 51 passages à niveaux sont établis aux intersections. Les passages à niveaux étaient tous accompagnés d'une maison de garde-barrière.
-
Murs
- calcaire
- brique
- fer
- enduit
- moellon
- pierre de taille
-
État de conservationdésaffecté, envahi par la végétation
-
Statut de la propriétépropriété d'un établissement public de l'Etat, voie appartenant à SNCF Réseau

- (c) Conseil départemental du Lot
- (c) Inventaire général Région Occitanie
Documents d'archives
-
Archives nationales, Inventaire-index des Ingénieurs des Ponts-et-Chaussées (1748-1932), Paris, 1993, 2008.
-
A.D. Lot, 73 S 1 : Notice sur les travaux et dépenses d'établissement de la ligne ferroviaire Cahors-Capdenac, dressée par l'ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, Lanteirès, en juin 1886.
-
A.D. Lot, 213 S 1-2 : Registres du service des chemins de fer (1880-1891).
-
A.D. Lot, 69 S 7 : Rapports de l'ingénieur en chef du contrôle de la voie et des bâtiments, ligne Cahors-Capdenac.
-
A.D. Lot, 74 S 4 : Ligne Montauban-Brive, section Cahors-Brive : Notice avec planches sur les travaux et dépenses d'établissement, dressée par l'ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, Pihier, vers 1890 (pour les modèles de bâtiment).
Bibliographie
-
La ligne de Cahors à Capdenac : de la Compagnie d'Orléans (P.O) à Quercyrail, éd. 2001.
Chercheur pour le Département du Lot depuis 2017.
Chercheur en inventaire du patrimoine pour le Département du Lot depuis 2019.

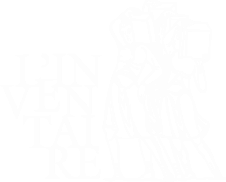


Chercheur pour le Département du Lot depuis 2017.